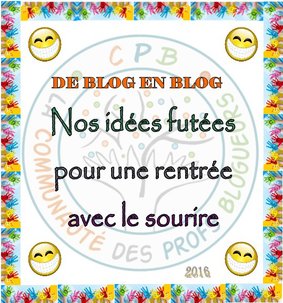
Bienvenue par ici ! Sans doute es-tu arrivé(e) chez moi en suivant le lien d’Enge.
Et oui, c’est vrai, ça sent plus la reprise que le départ en vacances…

http://dangerecole.blogspot.fr/
Bref, je ne vous l’apprends pas, la rentrée approche :

Mais bon c’est inévitable, on le sait dès le début. C’est comme le lundi après le dimanche, les coups de soleil après la plage ou les corrections après les évals.
En même temps, si les bonnes choses n’avaient pas de fin, saurions-nous les apprécier à leur juste valeur ? (vous avez 2 heures devant vous, posez les copies sur mon bureau en sortant – et si je dors, ne faites pas de bruit ^^)

C’est bon, vous êtes dans les starting blocks ? Chauds comme des baraques à frites ?

Sinon, c’est reparti pour une année de nouvelles aventures : des corrections, des réunions, des projets, de l’imprévu, des coups de gueule, des parents qui nous gonflent et d’autres qu’on ne remerciera jamais assez, des décrochages, des accrochages, des heures devant la photocopieuses (le toner sera forcément vide au mauvais moment), du stress, mais surtout des rires, de grandes satisfactions et beaucoup de fierté !
Profitez de ces bien de cette dernière semaine, savourez-la ! Et en cas de coup de pompe, la CPB est là pour vous remettre tout doucement les pieds dans le bain.
Pour découvrir la rentrée chez un autre cybercollègue, suis la chaîne en cliquant sur le logo :

Et n’oubliez pas :

http://dangerecole.blogspot.fr/
48 pensées sur « De blog en blog: Nos idées futées pour une rentrée avec le sourire ! »

Les bons plans, c’est pas fait pour rester au fond du placard ou être gardés pour soi. C’est pour ça que chaque mois, les blogueurs vous proposent d’aller découvrir une petite pépite d’article à côté de laquelle vous êtes sans doute passés.
Ce mois-ci, je vous emmène faire un tour chez lOu jO, avec 2 grands O, deux yeux bien ouverts qui vous regardent même dans le dos.
lOu jO a été remplaçante pendant 6 ans, et vient de poser son cartable dans une classe de CM1-CM2. Vous trouverez donc chez elle des ressources pour tous les niveaux, avec notamment des super séquences d’EPS, des billets d’avertissement qui valent le coup d’oeil et des pauses musicales pour fermer les yeux et se détendre.

Mais l’article dont je vais vous parler aujourd’hui, c’est en lien avec sa vie d’avant, sa vie de bohème de l’éducation. Comme vous allez être beaucoup à démarrer sur un poste de remplaçant à la rentrée et que cette perspective peut être angoissante, lOu jO partage avec nous ses conseils pour démarrer la journée sur de bonnes bases. Que faut-il prévoir ? Comment se passe l’arrivée à l’école ? Quels sont les gestes professionnels et les habitudes à avoir en arrivant dans une classe ?
Elle ne nous prépare pas la classe, mais déblaye grandement le terrain !
Trêve de blabla, je vous laisse aller découvrir son article :

Pour découvrir les autres coups de cœur du mois, c’est par ici :

7 pensées sur « Le coup de coeur d’août ! »
-
Waouh, et de 3 pour Lou jO ! c’est bien mérité ! chouette article mon filleul, des bises en passant…
OlivierI
Dimanche 14 Août à 10:04
Un vrai plébiscite !
-
Un vrai plébiscite !
-
Oh merci, merci, merci ! ♥♥♥
Je suis rouge jusqu’aux oreilles 😛
J’aime beaucoup ton article et ta façon adorable de parler de mon blog.
Des bises !!OlivierI
Mardi 16 Août à 09:33
Et promis, y a eu aucune concertation autour de ce coup de coeur avec Tibiscuit et Enge ! Tu fais vraiment l’unanimité ! Merci pour ce super article !
lOu jO
Mardi 16 Août à 20:23
Merci ♥
-
Et promis, y a eu aucune concertation autour de ce coup de coeur avec Tibiscuit et Enge ! Tu fais vraiment l’unanimité ! Merci pour ce super article !
-
Merci ♥
-
Cest un bel article et c’est tellement mérité 🙂 merci Oliver
OlivierI
Mardi 16 Août à 09:33
Enregistrer

Bonjour tous ! J’espère que vous profitez bien de vos vacances et que la suite sera tout aussi sympa !
Pour anticiper le début de l’année, je vous propose un projet d’art pour la rentrée. L’idée est de faire réaliser une production qui permettrait à l’élève de se représenter.

Oui, mais non. L’autoportrait ne sera que la première étape du projet. On va essayer d’aller plus loin et de les faire se représenter physiquement, mais aussi de faire transparaître leurs personnalités dans les productions.
Vous pouvez aussi découvrir un autre projet de rentrer par ici : http://ziletcompagnie.fr/autoportraits-en-agamographes/
Lors de la première séance, on va demander aux élèves comment ils pourraient se représenter. On les laisse chercher des exemples de réponses plastiques, et y a fort à parier que la seule chose qu’ils proposent, ce soit de dessiner leurs visages (un autoportrait, oui).
OK, on se lance ! Alors là, on peut en profiter pour leur glisser quelques notions de proportions pour le visage. On pourrait même faire un dessin par étapes grâce à ce site :

Pour ceux qui n’ont pas internet en classe, Djoum m’a fait parvenir le pas à pas en PDF et PPT. Merci à elle !!!
A chacun de personnaliser son propre portrait à chaque étape.
Comme oeuvre de référence, je vous propose un autoportrait de Van Gogh :

Vincent Van Gogh – Portrait de l’artiste (1889)
On observe la réalisation du fond. On peut essayer de l’imiter en observant les motifs et l’harmonie de couleurs.
On met en couleur à la craie grasse et on joue à Qui est-ce ? à la fin de la séance. Voilà une séance rondement menée ! Mais, au lieu de s’arrêter là, on va présenter quelques réponses que des artistes ont apporté à la même problématique du portrait.

On projette le tableau de Torres-Garcia et on laisse les élèves réagir : qu’est-ce qu’on voit ? Qu’est-ce que ça représente ? (vous trouverez les différents tableaux à agrandir en bas de l’article)

Composition – Joaquin Torres-Garcia (1932)
(Merci pour les infos M’dame Audrey)
Dans ce tableau, l’artiste a représenté sa vie sous forme de pictogrammes extrêmement simplifiés. On doit ensuite imaginer ce que chacun de ces symboles peut vouloir dire.
On poursuit en demandant de réfléchir à UN côté de la personnalité ou UN élément de la vie de chacun. On essaye (au brouillon pour commencer) de le dessiner à la manière de l’artiste, on simplifie le trait, on gomme les détails, bref, on va à l’essentiel. On reproduit sur 1/4 de A4, on met en couleur (aux feutres, pourquoi pas) et on a un échantillon de classe sous la main.

Pour la séance suivante, on propose à la classe de découvrir successivement 2 tableaux. On présente le premier et on laisse réagir : ce que l’on voit, ce que ça signifie. On arrive à la déduction que ces objets représentent la vie du peintre, c’est une sorte de portrait ! Ben oui, en même temps, c’est là-dessus qu’on travaille en ce moment.
Puis on découvre le tableau de Monet et on en déduit (plus vite ce coup-là) qu’il s’agit là aussi d’un portrait. La différence est que Monet a en plus représenté un lieu qui compte pour lui. On essaye de deviner les traits de sa personnalité qui se cachent dedans.
Puis on passe à une phase de réalisation. On réfléchie à des objets importants pour nous, des indispensables et on les découpe dans des prospectus, des catalogues de voyage, des magazines, … afin de les assembler dans une production semblable (présenter brut comme Hoogstraten ou bien dans un environnement personnel comme Monet).

Hoogstraten réalise son propre portrait à travers une collection de 21 objets qui sont retenus par deux lanières de cuir rouge sur un panneau de bois. Il nous livre de éléments-clés de sa personnalité : il fait allusion à sa qualité de peintre (le cahier, le pinceau), d’auteur (la plume et les deux tragédies dont il est l’auteur), son statut élevé (le sceau de cire à ses armes).
Pour le reste, on peut tenter d’imaginer ce à quoi ça correspond.
Par ici, vous pouvez voir des réalisations d’élèves à la manière de l’artiste.

Tiré d’une newsletter Artips :
« Une pile de livres, une palette, des pinceaux… Ces objets sont négligemment posés sur une table devant un papier peint très fleuri, comme s’ils venaient tout juste d’être abandonnés.
Le titre l’indique, il s’agit du Coin d’atelier du peintre Claude Monet.
Pourtant, si l’artiste n’apparaît pas dans le tableau, Monet signe ici un véritable autoportrait ! Avec, en prime, un petit pied de nez à son père…
Tous les éléments sont judicieusement choisis par le peintre pour évoquer sa propre vie.
Monet est alors un jeune homme de 21 ans, certain de sa vocation d’artiste : c’est pourquoi il place bien en évidence la palette et les pinceaux au premier plan.
Monet montre aussi quel genre de peintre il veut devenir. L’œuvre accrochée au mur n’est pas là par hasard. Ce paysage rappelle le style de “l’école de Barbizon”, un groupe d’artistes de l’époque. Ces derniers quittent leurs ateliers pour aller peindre en plein air et observer la nature de plus près.
Une démarche qui va beaucoup inspirer Monet et ses amis impressionnistes…
Et les armes suspendues au mur, alors ? Elles évoquent un épisode marquant pour Monet. Tiré au sort, il est contraint d’effectuer son service militaire. Son père lui propose une échappatoire : payer un soldat pour le faire à la place de son fils, à condition que ce dernier renonce à sa carrière de peintre !
Mais la vocation de Monet est si forte qu’il refuse la proposition paternelle et exécute son service militaire sans tricher.
Ce tableau est donc une manière pour lui d’assumer pleinement son choix de carrière, et tant pis si papa n’est pas content ! »


Maintenant que l’on a découvert l’autoportrait, ainsi que les 3 réponses d’artistes, on va proposer la consigne suivante :

On en débat : qu’est-ce que vous en comprenez ? Il s’agit de réaliser un portrait de soi en y mettant des éléments réellement personnels, de dévoiler des parties de soi que les autres ignorent.
Pour cela, on laisse quelques éléments au choix :
– support A3 ou A4
– choix du médium (et des outils)
On laisse chacun faire une esquisse de la réalisation imaginée. Les volontaires partagent leurs idées. Dans l’idéal, ils réinvestiront des idées piochées dans les 4 types de portrait vus.
Puis on passe à la réalisation proprement dite. Elle peut prendre 2 ou 3 séances.
Si des bandes apparaissent à l’affichage, cliquez sur Télécharger, puis Ouvrir avec… et choisissez votre lecteur PDF.

Un énooooorme merci à Djoum pour cette fiche, sur le modèle d’Orphys :

Lors de la réalisation, certains seront tentés de se représenter sur une partie de leur production. Afin que le portrait soit (plus ou moins) ressemblant, et maintenant que les proportions du visages ont été évoquées, on propose l’utilisation de ces modèles dans lesquels les élèves n’auront plus qu’à sélectionner, prélever, reproduire et assembler les différentes parties :

Pour l’évaluation, je demande tout d’abord aux élèves de se pencher sur leur travail. Grâce à des critères explicites, je m’intéresse à la qualité de la réalisation :
- L’aspect productif : maîtrise technique ;
- L’aspect expressif : implication personnelle dans la réalisation et originalité de la production ;
- Les liens faits entre sa démarche et celles des artistes présentés ;
- L’intention de la création : même si la réalisation n’est pas parfaite, qu’est-ce que l’élève a essayé de faire ?


Composition – Joaquin Torres-Garcia (1932)

Samuel Van Hoogstraten – Nature morte en trompe-l’oeil (1666)

Claude Monet – Coin d’atelier (1861)
Oui, je sais, j’ai l’immense chance d’être dans une école avec des effectifs très trèèèèèèèès bas. Il n’y a que 5 CM, alors je vous le concède, c’est royal pour l’art visuel !
L’autoportrait :

A la manière de Torres-Garcia :

A la manière de Hoogstraten et Monet :
j’ai choisi de photographier les installations que les élèves avaient disposées sur une grande feuille de Canson noire, puis je les ai imprimées.

Les mêmes affichés :

Pour finir les productions et parfaire l’affichage, j’ai utilisé un cadre papier que j’ai agrandi (à la photocopieuse) et évidé. J’ai ensuite collé les production par l’arrière :

Comme d’habitude, ton article est une petite pépite!! Merci
-
Quelle séquence riche, intéressante, qui mêle pratique et histoire de l’art… Bref, c’est parfait! Bravo et merci. Sûr que je vais démarrer l’année là-dessus
Merci les filles ! Ravi que ça vous intéresse !
-
Super projet !
-
J’adore l’outil proposé avec toutes les sortes de nez, yeux, coupe de cheveux,……. super, merci!
-
Mais qu’est ce que c’est bien!! Tes articles sont toujours un bonheur! Merci beaucoup
-
Et merci à toutes les 3 pour votre petit mot !
-
Wahou quel beau travail ! J’enregistre tout, et je suis sûre que ça va faire un tabac ! Bonnes vacances Olivier !
OlivierI
Jeudi 11 Août à 08:43
Très content de te voir par ici et que ça te plasir Alice ! Bonnes vacances toi aussi!
-
Très content de te voir par ici et que ça te plasir Alice ! Bonnes vacances toi aussi!
-
Top top! Je vais m’inspirer de certains points pour transposer aux cycles 2, j’adore le tableau avec les pictos!
OlivierI
Dimanche 28 Août à 08:39
Je veux bien que tu me racontes comment tu l’as adapté !
-
Je veux bien que tu me racontes comment tu l’as adapté !
-
Merci beaucoup pour cette séquence qui tombe à pic pour la rentrée !
OlivierI
Dimanche 28 Août à 08:40
De rien !
-
De rien !
-
Un super projet pour bien commencer l’année ! Avec une proposition qui laisse place à la création et non à la simple imitation comme on peut souvent trouver 🙂 j’adore pour commencer l’année ! Merci !
OlivierI
Dimanche 28 Août à 08:40
Avec plaisir !
-
Avec plaisir !
-
Très riche et très intéressant, encore une fois bravo
OlivierI
Dimanche 4 Septembre à 09:55

Voilà, voilà, je boucle cette rubrique Exploitation d’oeuvres, des oeuvres à exploiter. L’idée était d’avoir les ressources suffisantes afin proposer une promenade en Histoire des arts à travers le temps, quelque chose de suffisamment complet pour pouvoir être utilisable sur l’ensemble de l’année. Je pense avoir atteint mon objectif. C’est pas exhaustif, certes, je ne propose rien concernant la préhistoire ou l’antiquité, ce sont deux périodes qui me bottent moins en terme d’art. Mon autre mea culpa concerne le fait que je ne me suis intéressé qu’à la peinture, mais c’est tellement riche ! J’ai toujours essayé de ne pas tomber dans le saupoudrage pédagogique, chose que j’aurais l’impression de faire en brassant tous les domaines de l’art. J’ai préféré construire des connaissances plus solide dans UN domaine, c’est un choix.
Peut-être que cette rubrique continuera à s’enrichir au fil des projets, des envies, des rencontres. Aujourd’hui, c’est une oeuvre du XXe siècle sur laquelle on se penche !
Mais qui a foutu un tel b***** ?!!!

Y a de quoi rester assez dubitatif devant ce tableau… Que dire ?… C’est… surprenant, euh…. original… Ça change d’un Rembrandt… Il va être difficile de faire une analyse de la lumière ou de la composition…
Allez, on se reprend. Alors, qu’est-ce que j’ai sous les yeux ? Des formes. Ah oui, j’ai des formes ! Y a des ronds, des segments, des lignes courbes, brisées, des triangles, des rectangles, des damiers, …
Et puis des couleurs : du jaune, du rouge, du bleu (comme son nom l’indique), mais aussi du violet, un peu de vert, d’orange, des nuances de ces couleurs.
Même en prenant le temps de poser son regard, ce tableau reste assez hermétique. Mais qu’est-ce que Kandinsky a voulu nous montrer ?
On essaye de regarder plus finement ce tableau, de le décrire du mieux que l’on peut, une fois passé l’effet de surprise.
Observons les formes :

|
Les cercles tout d’abord : à part la forme, peu de points communs entre tous. Des p’tits, des gros, des monochromes, des multicolores, des simples, des superposés les uns sur les autres… Et le plus gros, celui de droite, qui est recouvert d’un tas de … « trucs ». Qui a dit que les cercles se ressemblaient tous ?
Sans parler des arcs de cercles présents dans la composition également. |
|
 |
Apparaissent aussi des carrés, des rectangles, des damiers, des quadrilatères plus ou moins orthogonaux. |
|
Et puis on a des lignes : des lignes ouvertes, des lignes fermées, des rectilignes, des courbes, des fines, des épaisses, des courtes, des longues… Bref, encore un éventail très varié de cet ingrédient.
Ben voilà ! Vous voyez qu’on arrive quand même à distinguer des trucs dans cette image ! |
 |
Privé de ses couleurs, voici ce à quoi ressemble Jaune Rouge Bleu Blanc Blanc Blanc :

D’après mon expert de 5 ans, à la maison : « il a fait n’importe quoi en s’appliquant, en mettant des jolies couleurs ».
On peut aussi relever que sur la moitié gauche du tableau, ces formes sont toutes placées les unes à côté des autres. Certaines se chevauchent mais l’ensemble reste épuré, tandis que la moitié droite est son opposé. Tout se mélange : les formes, les couleurs, elles sont toutes les unes par dessus les autres. On a finalement deux ensembles de masses qui cohabitent, mais qui sont strictement l’inverse l’une de l’autre !

Et les couleurs dans tout ça ? Regardez bien :la masse de gauche dégage une impression majoritaire de JAUNE (et des nuances orangées) tandis que la masse de droite renvoie un BLEU foncé, mêlé de NOIR. Et au centre, c’est du rouge.
Et le « décor » ? C’est l’inverse, l’arrière plan à gauche est fait de violet (nuance du bleu) tandis qu’à droite, on retrouve le jaune. A ces couleurs dominantes, on peut y observer des dégradés. On a bien une opposition entre couleurs chaudes et couleurs froides, dans les masses et dans les arrières plans.
Bref, on constate qu’une vraie dualité existe dans la composition : au niveau des formes, des couleurs des masses, des couleurs des arrières-plans. Donc :
|
Vassily Kandinsky (1866-1944) est un peintre Russe (naturalisé français en 1939), mais aussi un théoricien de l’art et un musicien (détail qui a son importance). C’est lui l’inventeur de l’art abstrait et il est considéré comme l’un des plus grands peintres du XXe siècle, aux côtés de Picasso ou Matisse. Il n’a pas débuté la peinture en réalisant des tableaux abstraits, mais c’est le résultat d’années de recherches et de réflexion qui l’ont mené à ne plus représenter le réel, à abandonner la peinture figurative (celle qui représente le monde). C’est un virage dans l’histoire de l’art ! Inutile donc de chercher à reconnaître des intentions de représentation de tel ou tel objet ou personnages dans une peinture abstraite. |
 |
La légende raconte que Kandinsky a pris conscience du potentiel expressif de l’abstraction le jour où, dans son atelier, il a découvert un tableau qu’il ne connaissait pas et qui le troubla… jusqu’à ce qu’il se rende compte qu’il s’agissait de l’une de ses toiles posée à l’envers. Mais le fait d’être touché d’une manière ou d’une autre par des formes et des couleurs qu’il n’identifiait pas a été un premier pas vers l’abstraction.
Il a considéré qu’il était possible de susciter des émotions chez le spectateur en associant des formes et des couleurs, des points et des lignes. Il s’agit des composantes plastiques élémentaires, et leur association réfléchie permet de faire naitre des émotions chez le spectateur. Un peu à l’image de la musique, dans laquelle une association de notes permet de provoquer joie ou tristesse en allant titiller l’âme de l’auditeur.
|
|
|
|
Composition n°8 Vassily Kandinsky |
Trente Vassily Kandinsky |
Kandinsky a développé toute une théorie selon laquelle chaque élément produit un effet en fonction de son orientation. Par exemple, « la ligne horizontale possède une tonalité affective sombre et froide semblable au noir ou au bleu, tandis que la ligne verticale correspond à la hauteur, elle possède au contraire une tonalité lumineuse et chaude proche du blanc ou du jaune. Le point quant à lui résonne différemment selon sa place sur la surface de la toile, selon sa taille, sa couleur… » Histoires, d’arts en pratiques, P. Straub.
Pour découvrir l’évolution de sa peinture à travers sa carrière, CLIC par ici.
On peut déjà commencer par dire que c’est un art dans lequel les œuvres ne font aucune référence à la réalité. Il n’y a aucune intentions de représenter quoi que ce soit qui existe. Il s’agit d’une théorisation de l’art poussé à l’extrême.
Cet art est basé sur une absence de formes naturelles, il se base sur des formes géométriques. Les peintres s’appuient également sur les variations de couleurs, les nuances, les oppositions clairs/foncés, le mouvement engendré par la composition créée, les textures ou encore les équilibres créés.
« Un tableau abstrait n’a pas de sujet, il n’est donc pas rattachable à un genre, et son titre ne peut renvoyer qu’à des aspects formels ou rester dans des concepts très généraux (par exemple « Composition » ou « Variation ») avec un numéro ou une date.
Regarder un tableau abstrait relève donc d’une attitude intellectuelle très particulière : dans l’absolu, il faudrait recevoir l’image sans rien projeter sur elle, sans essayer à tout prix d’y « reconnaître » des personnages ou des objets, sans essayer de comprendre, se promener en liberté dans un univers de formes et de couleurs, se laisser porter par sa propre rêverie, son propre jeu intellectuel, son propre voyage mental… Car les tableaux abstraits sont en fait des paysages mentaux. » Un jour, une oeuvre, Renée Léon
Inutile donc de chercher à se raccrocher à quoi que ce soit : il n’y a rien de reconnaissable dans une toile abstraite. Il faut juste la recevoir, se questionner intérieurement pour chercher ce que ces tableaux suscitent en nous.
Revenons à notre tableau : on s’était arrêté à l’idée que les deux moitiés s’opposaient (par le choix des formes utilisées et la manière dont elles sont disposées, par les couleurs présentes dans les masses mais aussi par celles de l’arrière-plan). Ici, on va pousser l’analyse un peu plus loin pour se rendre compte que la dichotomie de ce tableau est plus importante encore.
|
|
Les lignes : celle de la moitié gauche sont fines, rectilignes, tandis que celles de droites sont épaisses et sinueuses.
Les couleurs : on n’en avait pas encore parlé, mais ces trois couleurs choisies pour former le titre correspondent aux trois couleurs primaires, celles qui sont à l’origine de toutes les autres ! Et ce n’est pas un hasard. |
La moitié gauche renvoie une impression de légèreté, de couleurs lumineuses, chaudes tandis que la moitié de droite montre des couleurs « lourdes » et froides. Par les couleurs, la moitié gauche donne alors une impression de mouvement, de dynamisme alors que celle de droite parait stable, immobile.
La composition : et là, c’est tout le contraire ! On ne sait plus sur quel pied danser. Les formes utilisées par Kandinsky sur la moitié gauche renvoient à la stabilité (lignes horizontales, rectangles) et celles de la moitié de droite induisent du mouvement (lignes courbes, formes qui se superposent, …) .
On notera la présence parmi les couleurs de rouge (la passion, la vie), de vert (apaisant), ou de noir et de blanc (neutres tous les deux).
On se retrouve encore une fois dans une situation d’opposition entre les deux moitiés : elles s’opposent MAIS se complètent l’une l’autre. C’est une histoire d’équilibre fragile, de désordre harmonieux. On retient donc ici que l’essentiel de ce tableau est dans l’équilibre des éléments qui se répondent dans un jeu d’opposition et de complémentarité.
J’hésite à aborder cette partie. Après avoir expliqué qu’il ne faut pas chercher à identifier quoi que ce soit dans une oeuvre abstraite, c’est pas malin (mais tellement intéressant, alors on y va) !
Une opposition Jaune / Bleu foncé-noir, ça ne vous évoque rien ? Vraiment ? Il pourrait être question du jour et de la nuit, une opposition doublée d’une complémentarité.
|
|
Cette géométrie, ces couleurs chaudes, les cercles, les obliques qui rappellent les rayons. C’est lumineux, c’est chaud. On peut se projeter sans prendre trop de risques : le soleil est évoqué ! |
|
| Et de ce côté-là, ce cercle obscure d’où s’échappent des formes, ces surfaces qui se chevauchent, qui apparaissent par transparence. C’est la nuit qui est évoquée. |  |
On peut même pousser l’interprétation un peu plus loin. Peut-être avez-vous vu apparaitre deux semblants de visages parmi ces formes, qui seraient la personnification du jour et de la nuit. On peut penser voir apparaitre un oeil et un nez sur la masse de gauche (le soleil) et la tête, un oeil et deux plumes qui viendraient coiffer la Nuit.
 |
 |
Bien sûr, il s’agit là d’interprétations. Cependant, des notes de cours que Kandinsky avait dispensés en Allemagne, au Bauhaus, évoquent LA NAISSANCE DES COULEURS :
« Phébus (dieu du soleil) et la lune s’évitent et se retrouvent quand même entre le jour et la nuit, comme l’aurore et le couchant. Naissance mystérieuse du rouge par la tendance simultanée à l’éloignement et à l’ascension du jaune et du bleu ».
Ce tableau pourrait alors nous raconter la naissance du rouge, fille du Jour et de la Nuit.
C’est beau et poétique, n’est-ce pas ? A l’origine, il existerait 2 couleurs (le bleu et le jaune) et le rouge serait alors le fruit de leur union, puisqu’il n’apparait que lorsque les deux astres se rencontrent, lorsque le ciel s’en teinte. Ces 3 couleurs primaires sont ensuite à l’origine de toutes les autres. On est donc remontés aux origines de la couleur. 
Et là, j’ai pas pu m’en empêcher !
La séance :
Si des bandes apparaissent à l’affichage, cliquez sur Télécharger, puis Ouvrir avec… et choisissez votre lecteur PDF.

Les tableaux à montrer au cours de la séance :

Number 34 – Jackson Pollock

Composition en rouge, jaune bleu et noir – Piet Modian

Relief disques – Robert Delaunay
La trace écrite (sur le modèle de Cenicienta)
Si des bandes apparaissent à l’affichage, cliquez sur Télécharger, puis Ouvrir avec… et choisissez votre lecteur PDF.

En pratique éclairante, je vais une nouvelle fois m’appuyer sur le travail de P. Straub. Il s’agit d’une proposition de travail tiré de son ouvrage Histoires d’arts en pratique. Il nous propose de créer une image en binôme. Deux peintres vont « s’affronter » dans un duel au cours duquel chacun va devoir conquérir un territoire en y déposant sa couleur. La zone centrale sera une sorte de ligne de front dans laquelle une nouvelle couleur va naître à partir des deux premières, tout comme dans l’oeuvre de Kandinsky :

Vous pouvez trouver une présentation de cette activité sur son site ICI (il s’en sert avec un autre objectif).
Au passage, n’hésitez pas à aller jeter un oeil dans son livre. Patrick Straub propose une super comparaison entre Number 34 de Pollock et Jaune Rouge Bleu. La mise en opposition de ces deux tableaux est vraiment intéressante ! Il oppose par exemple la réflexion concernant la présence et la disposition de chacun des éléments dans le tableau de Kandinsky aux tâches et coulées aléatoires de Pollock. C’est passionnant !
C’est toujours bien de te lire ! la suite la suite !!!!!!
OlivierI
Mardi 14 Juin à 19:52
Et ça me fait toujours plaisir de découvrir tes p’tits mots, merci Lala !
-
Et ça me fait toujours plaisir de découvrir tes p’tits mots, merci Lala !
-
Je découvre ton site. Je reviendrai. Merci beaucoup pour ces docs.
OlivierI
Mercredi 15 Juin à 17:31
Ravi de te lire et à très vite donc !
-
Ravi de te lire et à très vite donc !
-
Comme d’hab… C’est passionnant!!!
OlivierI
Mercredi 22 Juin à 19:22
Et comme d’hab’, c’est toujours un plaisir de te voir passer par ici !
-
Et comme d’hab’, c’est toujours un plaisir de te voir passer par ici !
Enregistrer

Mois de mai, dernière période, fin de projets en tout genre, mais pour la CPB ce n’est jamais la fin !
Nous vous proposons donc notre sélection des documents « à ne pas rater » !
Pour les découvrir:


0 pensées sur « Les docs du mois d’avril ! »
Enregistrer



































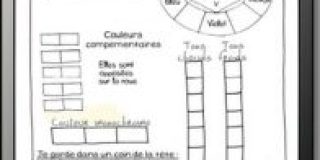

sympa ton article !!!
Sympa l’entraînement « chaud » comme des baraques !! Bonne rentrée mon filleul !
Coucou chez toi !! Bonne reprise !!!
Chaude comme une baraque à frites, peut-être pas encore, je vais piquer la corde à sauter de ma fille et je reviens! 😀
Hihihi extra ton article ! j’adore ces gifs
J’adore ton 1er gif mais moi j’ai hâte d’y être !!! Bonne rentrée !
Bonne rentrée !! (moi, c’est plutôt Cameron…)
Bonne rentrée à toi !!!
Bonne rentrée quand même !!!
hihii! tu m’as fait bien rire!! ce sera sans moi pour la corde à sauter mais pour le reste c’est ça! bonne reprise et merci pour ta participation!
Je m’marre d’autant plus que j’fais VRAIMENT de la corde à sauter… Et je vous le conseille , na :p ! Des bises en me baladant !
Je vais éviter la corde à sauter, je serais bien capable de me péter une cheville ^^
Bonne rentrée.
Merci capt’aine pour ce rappel, grâce à toi, moi aussi je suis prêt à mettre les frites dans le bain!!
Merci pour la rigolade. Bonne rentrée !
Très sympa ton article !!! Bonne reprise !
Chouette article ! Merci pour la rigolade et très bonne rentrée !
bonne reprise
Merci pour l’article et bonne reprise Olivier
« chaud comme une baraque à frite », va falloir changer tes références culturelles! 😉
Bonne fin de vacances et bonne découverte de ton nouveau terrain de jeu!
Bonne fin de vacances !
Merci pour le fou rire! Bonne semaine à toi avant la rentrée
Merci pour le sourire, et bonne rentrée à toi ! 🙂
Bonne fin de vacances et bonne rentrée !
Excellent!! Tout à l’heure j’étais plutot en mode Cameron!!
Très drôle ton article !!
Bonne rentrée!
Vive la rentrée!
Je vais me remettre à la corde à sauter …quand il fera un peu plus frais je pense!
Aaaaaah cher voisin tu es un vrai sourire à toi tout seul!
Bonne rentrée. 🙂
Bonne rentrée !
de toutes façons on n’a jamais été aussi près des prochaines vacances
en même temps on n’a jamais été aussi près des prochaines vacances
bonne reprise
Merci pour le sourire !
Bonne rentrée 😉
Extra ces gifs ! merci pour le sourire !
Belle rentrée à toi et merci pour ton article 🙂
Bonne rentrée
Ton article m’a bien fait rigoler!
Bonne rentrée!
Merci, tu m’as donné le sourire.
Très bonne rentrée !
Bonne rentrée
J’adore ton article !!!!! Bonne rentrée !!!
J’adore toujours ces vidéos !
Bonne rentré à toi !
Merci pour cet article bien sympathique et bonne rentrée à toi !
Merci à tous ! Je reviens tout juste de vacances, je fais mon petit tour dès que j’ai un moment !
Merci pour ce moment de sourires !
Contente de voir que tu as profité !
Très belle rentrée à toi, OlivierI !
Ce n’est plus la rentrée, mais j’ai quand même bien rigolé. Merci donc à toi pour cet humour de bon aloi.
OlivierI
Vendredi 28 Octobre à 11:36
L’ennui avec la rentrée, c’est son coté cyclique. D’ici une semaine, je peux faire remonter l’article ! Bienvenue par ici Spinoza, j’ai pas souvenir de t’avoir déjà croisé par ici 😉
L’ennui avec la rentrée, c’est son coté cyclique. D’ici une semaine, je peux faire remonter l’article ! Bienvenue par ici Spinoza, j’ai pas souvenir de t’avoir déjà croisé par ici 😉
Non, je n’étais jamais venu. Je viens de télécharger les diapos monuments et je trouve l’idée géniale. Je pourrai même l’utiliser avec mes CP en adaptant un peu les tâches pour faire une pause culturelle entre deux séances d’apprentissage des bases.
Ma fille de CM1 a adoré les deux premiers powerpoints. On fait la suite demain. Il est possible de faire la même chose avec des monuments de France pour la géographie française, des monuments d’Europe, des monuments anglais, espagnols, allemands, chinois.
C’est super chouette. Si j’avais du temps, je t’en enverrai plein, des powerpoints.
Je vais essayer d’en réaliser un demain avec ma fille sur un monument que tu n’as pas mis et je te l’enverrai.
OlivierI
Dimanche 30 Octobre à 11:39
Ravi que tout ça te plaise tant ! C’est des séances qui fonctionnent bien et il faut les épurer un peu pour les adapter aux CP.
Si tu réalises des diapos, ou même que tu en adaptes certains, je veux bien que tu les envoies pour que je les mette en ligne, merci !
Ravi que tout ça te plaise tant ! C’est des séances qui fonctionnent bien et il faut les épurer un peu pour les adapter aux CP.
Si tu réalises des diapos, ou même que tu en adaptes certains, je veux bien que tu les envoies pour que je les mette en ligne, merci !